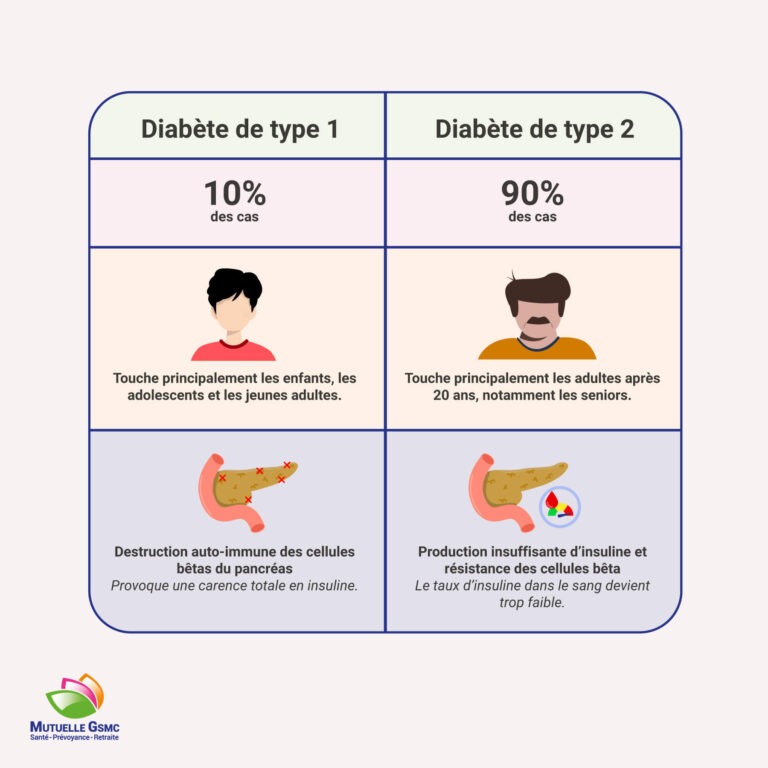1. Bien anticiper la sortie et évaluer les besoins
Une sortie de l’hôpital réussie commence avant même le départ. Une bonne anticipation, si elle est possible, est la clé d’un retour à domicile sans stress et sans rupture de soins.
La démarche doit être planifiée en amont avec un coordinateur de sortie ou l’équipe médicale de l’établissement. Ce rôle de coordination, peut, dans certains cas, être assuré par des programmes spécifiques de l’Assurance Maladie, comme le PRADO (Programme d’Accompagnement du retour à DOmicile), qui propose un service d’organisation pour certaines pathologies (orthopédie, insuffisance cardiaque, etc.).
L’évaluation porte sur plusieurs aspects essentiels et complémentaires. L’analyse des besoins médicaux du patient est essentielle : elle inclut notamment les soins infirmiers réguliers, la rééducation (physique, cognitive ou psychologique) ou la réadaptation.
En parallèle, il faut évaluer les besoins sociaux pour les aides à la vie quotidienne, comme l’aide à domicile, l’aide à la toilette, le portage de repas ou encore l’aide aux courses.
L’évaluation intègre aussi les besoins techniques, qui consistent à prévoir l’équipement pour l’autonomie (lit médicalisé, fauteuil roulant, etc.) et à s’assurer que le domicile est sécurisé et bien aménagé pour prévenir les chutes.
À lire aussi : Hospitalisation, tout savoir sur les coûts et remboursements
2. Gérer le transfert des informations entre professionnels
La sortie de l’hôpital s’accompagne toujours d’un transfert d’informations médicales essentielles. La lettre de sortie récapitule le motif de l’hospitalisation, les soins réalisés et les traitements en cours. Elle doit être transmise au patient, à son médecin traitant et, si nécessaire, aux professionnels de santé intervenant à domicile.
Le Dossier Médical Partagé (DMP) facilite cette transmission. Il permet un accès centralisé et sécurisé à l’ensemble des documents de santé : comptes rendus, ordonnances, résultats d’examens… Le contact direct entre l’hôpital et les professionnels libéraux (infirmiers, kinésithérapeutes, médecins, etc.) est préférable pour clarifier les modalités de prise en charge.
3. Organiser les soins à domicile
En fonction de l’état de santé du patient, plusieurs dispositifs peuvent intervenir :
- les Services de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) pour les soins quotidiens ou de rééducation ;
- l’Hospitalisation À Domicile (HAD) pour des traitements complexes nécessitant une surveillance rapprochée ;
- les infirmiers libéraux, pour les actes ponctuels ou réguliers ;
- les services d’aide et d’accompagnement à domicile, tels que le portage de repas, l’aide-ménagère ou encore l’accompagnement aux rendez-vous médicaux.
Le médecin traitant joue un rôle central : il coordonne l’ensemble des interventions, suit l’évolution de l’état de santé et ajuste les prescriptions si nécessaire.. Un planning clair et partagé, regroupant les visites à domicile, les prises de médicaments et les examens à venir, constitue un repère essentiel pour le patient et ses aidants.
Bon à savoir
Certaines mutuelles proposent une garantie assistance pour soutenir les assurés lors d’une hospitalisation ou d’une immobilisation à domicile. Selon les contrats, cette garantie peut inclure des services pratiques comme l’aide à domicile, la garde d’enfants, le portage de repas ou de médicaments, ou encore un soutien psychologique. Un coup de pouce précieux pour alléger les aspects logistiques et permettre de se concentrer sur l’essentiel : récupérer.
4. Soutenir les aidants
La sortie de l’hôpital bouleverse souvent le quotidien, non seulement pour le patient, mais aussi pour son entourage, que l’on nomme les aidants. Ces derniers sont une ressource précieuse, mais ils peuvent aussi être fragilisés, physiquement comme psychologiquement.
Quelques pistes pour accompagner au mieux les proches :
- Partager les bonnes informations : savoir quoi faire en cas de doute, connaître les gestes à adopter ou les signes qui doivent alerter rassure l’entourage et facilite la prise de relais au besoin.
- Encourager le dialogue : parler librement de ce que chacun ressent permet d’éviter les malentendus et de répartir les tâches plus sereinement. Si nécessaire, un soutien ponctuel d’un professionnel (psychothérapeute, psychologue) peut aider à mieux vivre la situation.
- Se relayer et accepter de l’aide extérieure : un service d’aide à domicile, un voisin qui passe, un ami qui accompagne à un rendez-vous médical… même de petites aides peuvent alléger l’organisation et laisser du temps pour souffler.
5. Assurer un suivi post-sortie
Les premiers jours après la sortie d’hôpital sont souvent les plus délicats, car le patient doit retrouver ses repères tout en poursuivant ses soins. Un suivi rapproché est recommandé pour détecter rapidement toute complication ou signe d’aggravation.
Selon les cas, il peut s’agir de visites médicales programmées, d’appels téléphoniques de contrôle, voire d’une réévaluation à domicile par l’équipe soignante.
Cette vigilance doit se prolonger aussi longtemps que nécessaire. Les besoins peuvent évoluer avec le temps : certains soins seront allégés, tandis que d’autres, comme la rééducation ou le soutien psychologique, pourront être renforcés.
À lire aussi : Comment retrouver sa féminité après une chimiothérapie ?
La Mutuelle GSMC vous accompagne…
Besoin d’une mutuelle pour vous accompagner à votre sortie d’hôpital ?